ENTRETIEN
L'échappée du cadre : entretien avec Nessa Kalfou.

Par Cases Rebelles
Avril 2020
Après Xonanji le mois dernier, nous continuons à vous présenter le travail artistique des membres de Cases Rebelles. Nessa KALFOU est l'une des membres piliers de Cases Rebelles. C'est aussi une photographe de longue date et de grand talent, même si elle partage son travail avec parcimonie et discrétion. Elle nous raconte ici sa venue à la photo, ses influences et la manière dont ses différentes histoires habitent son travail.
Est-ce que tu peux te présenter?
Je m’appelle Nessa Kalfou et je suis une photographe autodidacte afrocaribéenne, née et ayant grandi en France. Je suis également membre de Cases Rebelles... mais ça vous le savez.
Quand et comment as-tu débuté la photographie ?
J’ai toujours aimé prendre des photos mais c’est vraiment à partir de l’âge de 14 ans que j’ai commencé à prêter attention à la lumière, au cadre, au sujet. Prendre des photos c'était guidé par une intention, une idée de composition même très sommaire. J’ai commencé avec des appareils photos jetables et un compact, l’appareil photo familial. À l’époque, les jetables étaient pas chers. Les premières prises de vues, c’était de la fenêtre de ma chambre : j’ai commencé à photographier compulsivement la place du quartier populaire où on habitait, toujours du même endroit, et ce jusqu’à ce qu’on déménage quand j’avais 18 ans.

Personne dans ma famille n’avait une pratique artistique de la photo. En revanche, il y avait des albums de photos de famille - la vie de mes parents en Guadeloupe avant leur arrivée en France - et cela m'a toujours fascinée.
La pratique artistique est venue plus tard ; mon frère, lui, dessinait beaucoup à un très jeune âge, mes parents l’ont inscrit à un cours de dessin pendant une année je crois. Il a toujours continué dans cette voie et est devenu graphiste.
Je suis autodidacte. Je n’ai pas pris de cours ou suivi un cursus en Arts plastiques, je n’ai pas fait les Beaux-Arts ou d’autres écoles, je ne m’étais pas renseignée sur les formations à la fin du lycée. Pour être honnête, je crois même que ça ne m’a même pas traversé l’esprit à l’époque ; c’était l’histoire ou l’anglais qui m’intéressait.
Dès l’âge de 14 ans, j’ai tenté de convaincre mes parents de m’offrir un reflex ; en vain. Je pense que dans leur esprit, c’était juste un caprice, que ça me passerait. Donc j’ai continué avec les appareils jetables et le compact (ils m’en ont offert un pour mes 20 ans). Ça t’apprend une espèce de discipline (rires) et à bricoler un peu. J’ai été encouragée par mes ami.es. Quand j’étais à la fac, un ami a voulu voir mes photos. Il m’a fallu un certain temps avant d’avoir le courage de les lui montrer. Je redoutais vraiment sa critique : il avait étudié trois ans aux Beaux-Arts. Il m’a donné un avis honnête sur mes photos et m’a beaucoup encouragée à poursuivre ce que je faisais. C’était juste un avis, ça peut sembler insignifiant mais je me souviens m’être dit que peut-être que ce que je faisais n’était pas si anecdotique que ça.
J’étais plutôt une enfant observatrice, j’adorais regarder les gens, leur inventer des vies ou essayer de les comprendre à travers leurs actions, leurs gestuelles. Je m’attardais sur certaines démarches. Regarder la vie de cette position d’observatrice, ça me fascinait. C’était une autre manière d’être au monde. On disait de moi que j’étais une enfant timide voire craintive. On m’a souvent reprochée mon silence et mon regard, paradoxalement, trop insistant, inquiétant. Petite, j’ai passé des heures à contempler des inconnu.es sur cette place donc je ne sais pas, c’est peut-être tout naturellement que j’ai été attirée par la photographie (rires).
D’abord c’était un désir de documenter je pense, assez simple, j’étais là, c’était là. Pour éprouver, montrer qu’il y a d’autres interprétations, il y a d’autres points de vue sur cette place, sur ce quartier. Je photographiais énormément de ciels, les bâtiments, l’absence des êtres humains est frappante donc c’est ambivalent. Je pense qu’il y avait un évitement, un inconfort aussi vis-à-vis de ce quartier. Ce rituel était aussi une manière de m’ancrer, je pense, en dépit de tous les traumas ou la violence. C’était un moyen de réinventer, en agençant ces photos différemment. J’ai des centaines de photos de ce même cadre, de la même place.

Qu’est-ce qui t’inspire ?
J’ai toujours adoré déambuler dans la ville et observer, m’attarder sur n’importe quel détail. Je prends plutôt des photos de paysages, d’architectures ou même plus abstraites, moins figuratives. Je n’ai pas toujours une idée de départ, j’aime qu’il y ait une part de hasard. Cela ne va pas forcément conduire à des photos. Je crois que cette idée de flânerie, d’être dans l’espace public a quelque chose de grisant même si cela va avec son lot de tensions, de (micro)agressions.
Ces derniers temps, c’est vrai que la notion d’opacité m’intéresse. J’essaye, depuis que j’ai repris la photo, de conceptualiser plus en amont, soit de me servir de photos plus anciennes et d’en faire des montages (comme dans la série "Spectres" par exemple) afin de faire émerger un nouveau sens. Il y a cette forme de cristal, le macle que je trouve fascinant ; j’essaye de transposer, d’allier ça à la photo (rires). Je suis fascinée par le voyage dans le temps, les multiples dimensions qui nous composent, cette idée de multiples espace-temps que l'on porte en soi. Ce qui nous travaille, mine, à notre insu, plus ou moins secrètement.
Mes autres influences, pêle-mêle, c’est non exhaustif, c’est juste ce qui me vient : on m'avait offert le livre 25 and under dans lequel j'avais découvert les autoportraits de Carla Williams, c’était la première fois que je voyais des autoportraits d'une femme noire, des nus notamment. J’admire tout le travail d’Ingrid Pollard, il y a une telles variétés de techniques, de sujets. Et sinon en vrac : Rotimi Fani-Kayode, Jamal Shabazz, Gordon Parks... Récemment Ming Smith et le Black Photographers Annual publié par le collectif Kamoinge, Zanele Muholi, la série de paysage par Dawoud Bey sur l’Underground Railroad. Carrie Mae Weems, toute son œuvre est exceptionnelle, sa série "Roaming" que j’aime particulièrement, avec cette figure noire solitaire, toujours dos tourné à l’objectif. La photographe cubaine María Magdalena Campos-Pons, ses triptyques où elle explore les spiritualités afrocaribéennes, la question de l’identité, la manière dont la déportation esclavagiste marque les corps, le corps des femmes noires.
Longtemps, c’est le cinéma qui m’a influencée plus que des photographes particulier.es. Plus jeune je sais que je faisais attention à la photo des films, je me souvenais de scènes, de mouvements de caméra, de cadres. Bon, ado j’aimais beaucoup Gus Van Sant, Terrence Malick, Chris Marker par exemple ; c’était très masculin et plutôt blanc. J’aurais vraiment aimé faire ça, étudié pour être directrice de la photo : je regrette de ne pas l’avoir fait. Je connaissais aussi Arthur Jafa et son travail sur la photo de Daughters of the Dust, mais c’est Les rêves sont plus froids que la mort qui m’a subjuguée ; ça a été un choc ! (J'ai d'ailleurs ramené cette influence dans Dire à Lamine même si je n'ai pas vraiment participé à la réalisation). Je pense que si je devais m’essayer à la vidéo, j’irais dans cette direction : contemplatif, déroutant, on sent la réflexion constante sur la manière de faire apparaître les noir.es à l’écran (les images et les sons sont parfois désynchronisés, le temps devient malléable avec l’utilisation de la surimpression, du ralenti ; il y a aussi un travail sur le son incroyable). Oui, expérimenter avec la vidéo…. C’est quelque chose que j’aurais envie de tenter. J’admire également le cinéma expérimental du Black Film Audio Collective et plus particulièrement de John Akomfrah. Ils ont fait un travail documentaire exigeant intellectuellement pointu, hybride et engagé sur la représentation des émeutes de Handsworth, l’afrofuturisme, la migration, la postcolonialité, avec une incorporation et tout un travail de resignification des images d’archives.
Je pense aussi à des choses comme l'oeuvre de Marlon Riggs, la photographie de Restless City par Bradford Young ainsi que son boulot sur Pariah ; à Drylongso de Cauleen Smith ; à Kahlil Joseph et son clip pour Flying Lotus « Until the quiet comes » qui m’avait marquée ; aux films de Jenn Nkiru (leur hybridité, le chaos, le collage) ; au travail expérimental d’un Terence Nance qui m’intéresse beaucoup également.
Ma pratique est aussi nourrie par toute la littérature de la diaspora noire. Que ce soit de la théorie, des romans, de la poésie...
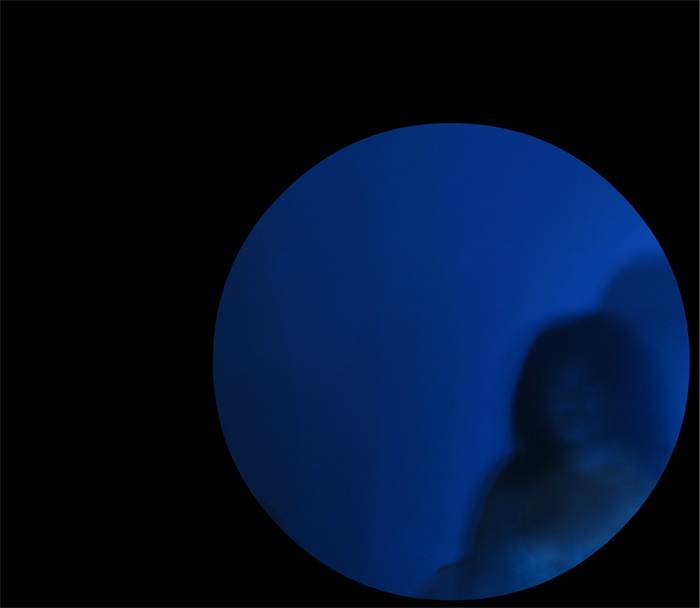
Il y a quelque chose de fascinant, d’angoissant et de déconcertant dans « Pariez sur mon silence » et la manière dont tu questionnes le régime de représentation du corps noir...
Oui c’est une série en cours. J’ai lu cette interview de Carrie Mae Weems avec Dawoud Bey, j’avais une citation d’elle en tête où elle disait que c'était comme si les noir.es opéraient sous un nuage d’invisibilité, qu'on devait détourner le regard d’eux.elles, et non pas se tourner vers eux.elles, comme s'iels portaient le signe de Cain. (Bon ça c’est une partie de la citation, il y a un passage un peu déconcertant et assez éloquent où elle disait que malgré l'élection d'Obama, toute la complexité, la richesse de la vie des noir.es restaient complètement occultées). Elle avait réalisé une série où elle recadre des photos ethnographiques, des photos d’esclaves par exemple, dont la plus connue prise est celle par Louis Agassiz, et elle ajoute des couleurs vives et un texte blanc dessus avec des commentaires sur le racisme scientifique ou des commentaires ironiques. Et moi je trouvais que c’était une réinterprétation qui était super audacieuse de ces clichés-là. C'était une manière de non pas neutraliser mais en tout cas faire voir la violence de la représentation, la figuration sur des photos, du dispositif photographique. Je trouvais intéressant de mettre en scène plutôt dans un entre-deux, pas complètement absent et pas complètement présent. Quand je parlais de dispositif atropopaïque, c'est comme si tout le dispositif photographique servirait à conjurer une présence un peu maléfique. J’aime bien cette idée d’invisibilité, de ne pas être saisie, de s’échapper de ce cadre là, de ne pas jouer le jeu. "Pariez sur mon silence", c’est une phrase qui peut être comprise comme un défi adressé à la personne qui regarde, comme un pied de nez. C’était aussi important de ne pas oublier la généalogie de la photo. C'était quand même aussi un outil scientifique de surveillance, de classification raciale, pour établir je dirais une sorte de typologie humaine. Un outil pour fabriquer, figer, débusquer chaque trace de non-humanité des noir.es. Un outil de terreur. C'est une réflexion qui a toujours été présente dans Cases Rebelles, dès la création du collectif et qui m'a poussée à penser autrement la représentation. Des analyses comme "Une image, mille mots et des baffes qui se perdent", "A la recherche de l'Underground", la tribune "Les corps épuisés du spectacle colonial" ou la critique de 12 Years A Slave. Je me dis qu’il y a quelque chose d’intéressant à s’échapper de la photo. Je fais aussi le parallèle avec les récits d’esclaves. L'écriture représentait une entrée dans l'humanité, une possibilité de reconnaissance de cette humanité niée. Il y avait souvent un portrait de la personne qui avait écrit le récit d’esclave. Ça devenait aussi une preuve d’humanité, une sorte de respectabilité ; je trouve ça intéressant de penser à comment s'échapper de ça.
Ta série « Spectres » procure un certain vertige : vertige du trauma, du cri, de l’inversion aussi, du bouleversement...
Le trauma c’est le fil des quatre séries que j'ai réalisées. Je parlais d’histoire personnelle et collective assez lourde, un héritage de violence, de trauma intergénérationnel, de secret donc oui je voulais recréer cette sensation - physique - de déchirement de soi, un truc dans les entrailles. Ça me fascine les photos de l'Univers, de l'espace, de cet infini. Je photographie des ciels depuis très jeune, c’est une obsession. Ces montages de la série Spectres, c'est comme une odyssée aux confins de la blessure. Une blessure qui prend les dimensions de l’univers. Le trauma modifie le monde, au niveau microscopique et macroscopique. Il modifie ta perception du monde, tu es happée dedans. Donc il y a une - des - inversions, un bouleversement total; c'est infini, sans début, sans fin. Il y a une citation de Cathy Caruth sur le trauma qui m'habite : "Ce qui revient hanter la victime ce n’est pas seulement la réalité de l’événement violent mais la réalité d’une connaissance partielle de cette violence." Il y a cette question de l’oubli aussi, de l’amnésie. C’est personnel mais c’est lié à une histoire plus longue et profonde.
Tu travailles aussi sur le vernaculaire et la récupération d’archives familiales. Quelles histoires essaies-tu de raconter?
Je disais précédemment qu’il y a beaucoup d’albums de famille chez moi, beaucoup de photos de la vie de mes parents, de leur vie avant en Guadeloupe. Il y a un récit que mes parents transmettent et il y a autre chose que moi, finalement, je vois dans ces photos-là. Il y a l’exemple de cette photo où de ma mère et de ses collègues : elle travaille dans une caserne de pompiers donc il n’y avait que des hommes blancs. Il y a cette photo de moi à un anniversaire où moi aussi j’étais dans cette situation où il n’y avait que des petits garçons blancs, et j’ai l’air mal à l’aise. Au-delà des échos et d’une expérience un peu commune... c’est hyper instinctif, quand je vois ces photos je dis oui il y a quelque chose à dire sur les conditions de femmes noires en France. J’étais une enfant, ce n’est pas exactement la même chose mais ma mère me raconte cette histoire sans ce côté prédateur, alors qu'elle sur la photo on dirait une proie, elle est isolée. Elle ne raconte pas ça du tout comme ça. Je me dis que ça dit quelque chose aussi du secret de famille, des récits - qui par leurs omissions, leurs silences - conduisent à une nouvelle exposition à la violence.
Quel est ton lien aux Caraïbes?
Je pense que c’est ambivalent, c’est un lien un peu distant. C’est quelque chose qui m’a hantée. Plus je grandissais, plus je m’en éloignais. Mes parents sont guadeloupéens, ma mère est afrodescendante et mon père indo-caribéen. Enfant, je pense que j’avais ce lien-là avec la Caraïbe parce qu’on allait en vacances là bas. L'ambivalence c'est parce que nos parents nous ont élevé.es en parlant créole : je le comprends mais je ne le parle pas. Mais nous il fallait qu’on soit quand même un peu assimilé.es. Ils ne nous ont pas du tout élevé.es dans un mépris de la Guadeloupe ou des Caraïbes, mais les Caraïbes c’était eux, nous on était plutôt "français.es". Et je pense que moi je suis passée par une forme, pas de rejet mais de distance. J'y suis revenue - ce n’est pas très original - par un autre espace des Amériques - les États-Unis, des littératures, des histoires américaines. Et comme ça je suis revenue petit à petit vers la Guadeloupe, en passant par les Caraïbes anglophones. Je pense qu’il a fallu passer par l’ailleurs. Intellectuellement, affectivement et politiquement - j’y étais attachée mais c’est par les livres et les recherches que c’est devenu plus concret dans ma vie de tous les jours. Alors dans la photo je ne sais pas comment ça se manifeste vraiment. Je pense qu’à un moment j’ai ressenti un besoin de retourner vers la Guadeloupe. Et ça s’est fait aussi avec des rencontres, du militantisme, avec Cases Rebelles. Je peux ajouter aussi que peut-être le refoulement ou la honte a joué un rôle. Je m’en suis rendu compte parce que je travaillais sur des néo-récits d’esclaves. C’est ça qui m’a amenée à me documenter sur la théorie sur les traumas, les traumas transgénérationnels, etc.
Qu’est ce que représente l’Inde pour toi?
D’abord, je n’ai pas un lien fort avec l’Inde en tant que telle : j’ai un lien avec une culture, une histoire indocaribéenne par mon père, ce qui est très différent. Ses ancêtres étaient des travailleur.ses engagé.es indien.nes. Je porte cette histoire de l’engagisme. Je sais qu'une partie de ma famille venait du Sud de l’Inde. Ce lien à l’Inde existe à cause de cette histoire d’exploitation, de colonisation et d’esclavage. Récemment, je me suis intéressée à l’histoire du système de caste, aux luttes des Dalits, après la découverte des Dalit Panthers.
Je refuse donc catégoriquement de me complaire dans un attachement superficiel, artificiel à une Inde fantasmée, monolithique tout comme je me méfie d’une revendication de l’indianité dans un but de distinction. Oui, il y a quelque chose de valorisant à se reconnecter à l’Inde, à “une culture indienne” (qui se retrouve sacrément uniformisée, simplifiée…) tandis que les cultures noires, elles, seraient moins complexes, moins riches. Selon moi, cette affiliation permet aussi d’échapper, de se sauver de la négritude, qui ne serait définie que par l’abjection absolue, le manque. Il n’était pas rare d’entendre dans ma famille paternelle : "Nous les Indiens, on a su conserver notre culture, pas comme les esclaves, pas comme les noir.es." Même si c’est faux, peu importe. J’ai donc grandi dans ça et surtout me suis construite en opposition totale à ce genre de réflexions négrophobes. Je me suis toujours définie comme noire et on m’a toujours perçue comme noire – je n’ai pas “un passing indien”, avec les mille guillemets qui s’imposent mais disons que selon des critères extrêmement étriqués, on ne me perçoit jamais comme indienne.
Et il y a eu aussi une rupture dans la transmission : mon père qui est arrivé à la fin des années 70 ici en France, s’est trouvé dans une situation ultra ultra minoritaire : pas de temples, pas de véritable communauté indocaribéenne. Il nous a cependant toujours raconté des histoires sur sa vie de travailleur agricole dans les champs de canne, sur notre arrière grand-père, un pousari, sur la vie quotidienne, les cérémonies etc. mais heureusement il ne m’a pas donné une vision figée de la communauté non plus.
Plus jeune, seule l’histoire des noir.es me passionnait. Je suis revenue à l’histoire indocaribéenne d’abord via un travail universitaire en littérature : j’avais le désir de travailler sur des œuvres qui croisaient ces histoires de la déportation esclavagiste et de l’engagisme. C’est aussi une redécouverte personnelle, à travers les récits de mon père que j’ai pris l’habitude désormais d’enregistrer et une recherche dans des travaux publiés sur les indocaribéen.nes. Certaines œuvres ont été très importantes pour moi.1
C’est ma venue au militantisme, ces quatre dernières années, qui m’a également poussée à m’intéresser aux solidarités afro-asiatiques, aux indien.nes dans les luttes syndicales guadeloupéennes et les résistances d’indien.nes dans les plantations aux 19ème siècle – non pas pour trouver des héros ou héroïnes mais pour aller à rebours d’une historiographie qui véhicule, reconduit parfois trop cette image de l’indien docile et ingénieux, avec en creux une comparaison avec les noir.es rétifs, rebelles. J'ai ressenti ces derniers temps le besoin d'échanger avec d'autres personnes de la diaspora indienne, d'autres afro-indien.nes.
Quels sont tes projets en cours?
Je continue ma série « Pariez sur mon silence ». J’aimerais essayer des nouvelles techniques d’impression aussi. Penser mes photos dans un autre format, prendre en compte leur relief, leur texture et les penser autrement dans l’espace, pas dans un espace autre que “virtuel” (en ligne). Sinon depuis plusieurs années j’ai envie de documenter la « rénovation urbaine » et la gentrification que subit le quartier populaire où j’ai grandi ; plutôt un format reportage, avec des témoignages dans l’idéal, mais ça demande énormément de préparation en amont.
Je réfléchis également à une manière d’aborder cette histoire afro et indo caribéenne, je ne sais pas si je veux privilégier une trame autobiographique, familiale ou plutôt centrer ou croiser tout ça...
Et j’aimerais faire plus de portraits, des portraits de mes proches, je suis nulle en portrait! (rires)
Où peut-on voir ton travail?
J’espère avoir bientôt plus de séries à montrer, mais vous pouvez voir mes photos sur mon site: nessakalfou.com

Tu as grandi à Nantes, 1er port esclavagiste de France dans un quartier populaire, comment penses-tu que ça a marqué ton regard?
Les séries « Cadres de la blanchité » et « Solitudines », ce sont des séries qui sont assemblées rétrospectivement, donc 15 ans après. C’est vraiment un retour sur une partie de ma vie. Dans les 20 ou 30 premières années, j’ai été entourée par la blanchité et ça semble tellement évident en regardant les photos, mais je pense qu’il y a quelque chose que je ne voulais pas voir. L’isolement. Ça se voit aussi ; il n'y a pas de photos de gens de mon quartier par exemple. Ça c'est dû au fait qu'il y avait un contrôle chez moi et je ne pouvais pas sortir comme je voulais parce qu'il ne voulait pas que je "traine" trop dehors, qu'il n'y avait soi-disant rien à faire. Alors que dans le centre ville de Nantes hyper-bourgeois, pour mes parents paradoxalement ça allait. J’étais dans un lycée bourgeois donc j’ai quand même eu ce vécu de transfuge de classe à un moment. J’imagine que j’avais cette aspiration. Je ne le formulais pas comme ça à 15 ans mais j’ai dû quitter mon quartier, m’en détacher pour des question bêtes d’orientation, de formation. Plus j’y réfléchis, plus c’est aberrant. J’ai été acceptée dans ce lycée-là et je côtoyais des personnes blanches, bourgeoises mais j’ai toujours ressenti un décalage. J’étais à la fois à l’intérieur et à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas cet ensorcellement de la blanchité mais il y avait quand même quelque chose de brutal. Mais c'est certain que ce mouvement vers ce lycée blanc, vers le centre-ville avec des copines qui venaient du même quartier populaire mais qui étaient blanches, moi ça m'a empêchée de regarder autour de moi et d'aller vers les noir.es et les gens de mon quartier plus généralement, au niveau photographique. Sinon oui, c’est paradoxal d’avoir grandi dans le premier port négrier de France même à une époque, les années 90, où la ville commençait à revenir sur son passé, limitée par les réécritures de l’histoire. Il y avait « Les Anneaux de la mémoire » mais ça c'était loin - et j'en ai entendu parler très tardivement. C’était une mémoire qui était vivace chez nous à la maison mais à l’extérieur, même à Nantes, c’était pas très visible. Et quand ça a commencé à l’être, il y a eu cette statue sur le Quai de la Fosse, qui a été saccagée et enchainée. Le Mémorial n'existait pas à l'époque: il est invisible de toute façon et c’est un mémorial à l'abolition. Encore une distorsion de l’Histoire.
* * *
Interview réalisée le 8 avril par Cases Rebelles.
Plein d'amour pour Nessa, notre sœur adorée !
- Des ouvrages comme La migration de l’Hindouisme vers les Antilles (Max Sulty, Jocelyn Nagapin), L’Inde dans les arts de la Guadeloupe et de la Martinique (Benoist, Desroches, L’Étang, Ponaman), Les Indiens de Guadeloupe (Singaravélou), les thèses et articles de Christian Schnakenbourg ou les œuvres de David Chariandy, Shani Mootoo, Mahadai Das, Harold Sonny Ladoo. [↩]
